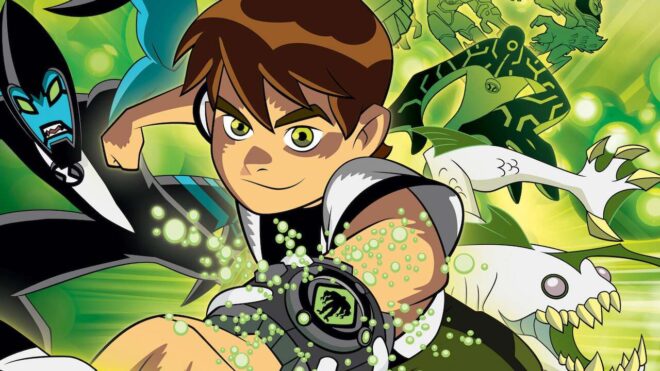Avec Twin Peaks: The Return, David Lynch défie les catégories classiques entre petit et grand écran.
Avec Twin Peaks: The Return, David Lynch défie les catégories classiques entre petit et grand écran.
Une frontière brouillée : série ou film ?
Les débats n’en finissent pas autour de Twin Peaks: The Return. Depuis sa diffusion sur Showtime en 2017, cette suite tant attendue de la série culte signée David Lynch et Mark Frost continue d’alimenter une controverse singulière : s’agit-il vraiment d’une simple série télévisée, ou d’un film éclaté en dix-huit parties ? Il suffit de rappeler que les prestigieux Cahiers du Cinéma l’ont désignée « meilleur film » de la décennie en 2019. Même le célèbre classement de Sight & Sound l’a hissée parmi les œuvres majeures du septième art. Pourtant, comment justifier qu’un feuilleton diffusé chaque semaine puisse prétendre à ce statut ?
Un maître du format libre
La question trouve ses racines dans la démarche même de David Lynch. Peu enclin aux carcans, le réalisateur a plusieurs fois martelé sa vision : « Télévision et cinéma, pour moi, c’est exactement la même chose… Raconter une histoire avec des images et du son. Cela s’est terminé en 18 heures ». Un point de vue qui tranche avec les conventions traditionnelles du secteur. Signe de son intransigeance créative, lorsqu’il s’est vu imposer neuf épisodes par la chaîne au départ, David Lynch a purement quitté le projet. Les discussions n’ont repris qu’à la condition essentielle suivante : obtenir un budget verrouillé et garder toute liberté sur le découpage des épisodes.
La négociation fut épique — l’équipe dirigeante de Showtime ayant dû se déplacer chez lui pour relancer le dialogue, apportant des cookies comme gage de bonne volonté. À l’arrivée, un compromis audacieux : budget fixé, mais aucune contrainte sur le nombre d’épisodes. Résultat : dix-huit chapitres livrés au lieu des neuf prévus initialement.
Une expérience à part entière
Ce choix a permis à Twin Peaks: The Return d’offrir une expérience télévisuelle totalement imprévisible. Chaque épisode réservait son lot de surprises — plongées surréalistes dans d’autres dimensions, séquences musicales au Roadhouse ou instants comiques portés par l’improbable duo Gordon Cole-Albert Rosenfield… Le tout ponctué par une réflexion subtile sur la nostalgie et la difficulté à faire la paix avec le passé.
Si certains épisodes ressemblent à des courts-métrages autonomes, leur articulation hebdomadaire inscrit pourtant l’ensemble dans une logique sérielle affirmée : chapitrage clair, récurrence musicale, points de rendez-vous scénaristiques… Certes, on peut envisager un visionnage continu. Mais force est de constater qu’en matière d’expérience spectateur — rythmes, attentes, habitudes — il s’agit bel et bien d’une série pensée pour un suivi épisodique.
Cinéma vs télévision : fausse hiérarchie ?
En définitive, cette zone grise entre formats témoigne surtout d’un changement d’époque. À l’heure où streaming et productions ambitieuses effacent les anciennes frontières du récit audiovisuel, faut-il encore opposer cinéma et télévision ? Comme le suggère le vidéaste Thomas Flight dans son essai analytique (à voir absolument), préserver les spécificités propres à chaque médium pourrait être la clé pour garantir leur vitalité culturelle respective. Ou pour reprendre l’expression fétiche de David Lynch : « Gardez les yeux sur le donut, pas sur le trou. »
Source originale: www.begeek.fr